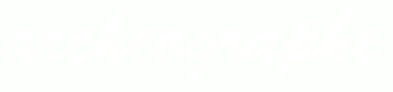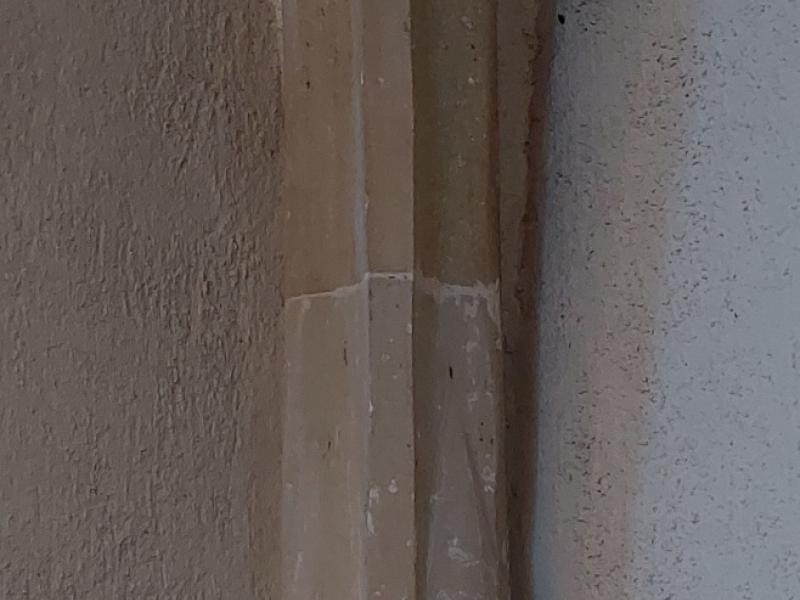Vous êtes ici
L'édifice
Architecture et aménagements
La chapelle St-Vincent est orientée, comme le sont la plupart des tombes du cimetière. Elle est construite en moellons et pierres de taille. L’édifice comprend une nef et un chœur au nord duquel est accolée une sacristie en appentis ; la maison du gardien lui est adossée à l’ouest. Le chevet est plat, avec deux contreforts à larmier incurvé qui en contrebutent les angles et soutiennent la voûte du chœur. Un oculus trilobé correspond, dans le chœur, à une crédence pratiquée dans l’épaisseur du mur. Un campanile, à l’aplomb de la 1ère travée de la nef, abrite les cloches1.
On entre directement au milieu de la nef par une porte latérale sur le côté nord. De plan basilical, la chapelle est caractéristique des églises-granges2. La nef forme un espace d’un seul tenant et comprend deux travées avec baies en plein cintre. Comme l'idique la clef de l’arc du portail, elle fut reconstruite en 1790 ; c’est aussi à cette date que l’on ajouta la sacristie et le logis du gardien.
L’arc triomphal, en anse de panier, donne accès au chœur, la seule partie qui subsiste de l’église d’origine ; son style, de la fin du gothique flamboyant, permet de placer la construction de l’église à la fin du XVe ou au début du XVIe s. Ce chœur est de plan carré ; il est voûté d’une croisée d’ogives dont les nervures apparentes se raccordent sans chapiteau au fût des colonnettes d’angles. La clef est ornée d’une fleur dans une guirlande de feuillage. Sous l’enduit blanc du plafond, là où il s’écaille, on distingue un fond bleu parsemé d’étoiles blanches. Ce chœur présente plusieurs aménagements : une armoire eucharistique, une crédence qui servait de tabernacle, sur laquelle donne l’oculus. A droite, on observe deux niches : l’une est une piscine, l’autre un enfeu. Toutes ces cavités ont un arc en accolade, sauf l’enfeu qui est couvert d’un arc en ogive. Les travaux de 1975 ont révélé trois fenêtres ogivales et deux cintres de portes gothiques, qui appartiennent à l’édifice originel et témoignent des profondes transformations qu’il a subies, sans doute à la Révolution.
Dans la fenêtre3 au-dessus de la piscine a été inséré un fragment de vitrail du XVIe s. D’une très belle facture, remarquable par ses riches coloris, il est comparable aux vitraux de Valentin Bousch4. On estime qu’il a pu être posé entre 1540 et 1550. La scène représente peut-être le martyr de saint Vincent: un saint évêque (saint Valère de Saragosse ?) est en prière devant la dépouille mortelle d’un diacre (saint Vincent ?). Le donateur, tenant un livre, est agenouillé derrière l’évêque ; aux côtés de celui-ci, un jeune couple est également à genoux. Dans l’angle supérieur droit, Dieu le Père tient le globe terrestre dans la main gauche.
Travaux de restauration
Le bâtiment a été bombardé par les troupes françaises, allemandes et américaines pendant la Seconde Guerre Mondiale. En 1945, la chapelle était dans un piètre état. Les premiers travaux touchent les murs endommagés et le clocher entre 1945 et 1950. En 1975 se crée l’association des Amis de Saint Vincent, qui entreprend de 1975 à 1977 une vaste campagne de restauration sous la présidence de Michel Schmitt et le soutien actif de l’abbé Schleninger. Le 22 janvier 1977, à la fête de St-Vincent, la chapelle put être remise à la Fabrique de l’église par le président de l’association.
Mobilier
On remarquera dans la chapelle plusieurs pièces de mobilier. Sur le maître-autel, un buste reliquaire en bois du XVIIIe s. contenait les reliques de saint Vincent5. Toujours dans le chœur, deux statues en bois, posées sur des culots, représentent saint Wendelin, à droite, avec un mouton et une crosse qui rappellent qu’il a été berger, et sainte Oranne, à gauche, en habit de religieuse. L’arc triomphal est flanqué de deux autels latéraux du XVIIIe s., l’un avec une statue de la Vierge à l’Enfant, l’autre avec une statue de saint François d’Assise.
- 1. On faisait sonner les cloches quelques minutes avant et après minuit. Ce stratagème visait les sorciers et sorcières, qui avaient coutume de récolter leurs simples maléfiques à minuit : ils ne pouvaient savoir l’heure exacte et se trouvaient ainsi dans l’impossibilité de nuire.
- 2. La chapelle était peut-être pourvue d’un transept avant la reconstruction de 1790.
- 3. Le nouveau vitrail de cette fenêtre a été réalisé par l’atelier Schouler de St-Avold.
- 4. Valentin Bousch (vers 1490-1541) a travaillé à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port entre 1514 et 1520. En 1520, il est attaché à la cathédrale de Metz, où il réalise les verrières du chœur et du bras sud du transept. Il travailla aussi sur commande pour la bourgeoisie messine.
- 5. Elles ont disparu, sans doute au cours de Seconde Guerre Mondiale. Le buste a été entièrement rénové en 1976 par M. Scheffer, artiste-peintre de Marmoutier, et débarrassé du baldaquin qui le surmontait.