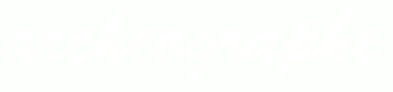Vous êtes ici
Aménagements urbains
La ville13 gallo-romaine s’étendait sur quelques 25 ha et pouvait compter 2000 habitants ; une petite partie en a été dégagée : restaurée et aménagée pour les visiteurs, elle forme un musée en plein air.
Conformément aux implantations urbaines romaines, les rues sont parallèles aux grands axes du cardo (nord-sud) et du decumanus (est-ouest)14 ; elles constituent un plan orthogonal où prennent place les insulae d’habitations, de locaux d’artisans et de boutiques, mais aussi les édifices religieux et administratifs. L’entrée du site se fait au sud d’un cardo (A)15, que l’on remonte jusqu’au croisement avec un decumanus (B). On est certainement dans une zone importante de la ville car ces voies sont bordées de portiques à colonnes toscanes, en particulier devant les maisons aisées, ou à supports de bois. Les trottoirs étaient ainsi protégés de la pluie et du soleil.
La chaussée est couverte de gravier ou dallée. Des canalisations, auxquelles sont reliées les édifices, courent le long des rues, en contrebas des trottoirs et des portiques. Ces larges égouts permettaient d’évacuer les eaux usées, mais aussi les eaux de pluie qui tombaient sur les toitures et que recueillaient des gouttières de pierre16. Ils étaient souterrains et recouverts de briques ou de dalles de grès. Ce réseau d’évacuation sillonnait toute la ville, il en est une des caractéristiques principales. Grâce à la déclivité, il aboutissait au Pfänderbach, un ruisseau qui se jette dans la Blies au sud de l’agglomération.
L’eau potable provenait de sources de la colline du Spelzenklamm, à proximité du site, et arrivait jusqu’aux usagers par un réseau de conduites. De longs troncs de chêne avaient été creusés à cet effet à l’aide de perceuses à cuillers ; ces tuyaux étaient reliés entre eux par des manchons de fer.17. On la recueillait aussi dans des puits, excavations carrées qui descendaient à une profondeur de 8,50 m pour atteindre une couche de gravier aquifère. A l’intérieur, les parois étaient recouvertes d’argile jusqu’au fond, afin d’éviter l’infiltration des eaux de surface corrompues, et garnies de grandes dalles. On puisait l’eau à l’aide d’un seau contrebalancé par une lourde pierre ; on a retrouvé certains de ces contrepoids au fond de quelques puits. Le puisage a laissé des traces d’usure sur les dalles, signe d’une longue utilisation.
- 13. Il s’agit en effet d’une petite ville, non pas d’un simple village.
- 14. Cette orientation idéale NS-EO est ici un peu décalée pour faciliter la pente des canalisations.
- 15. Se référer au croquis joint à cet article.
- 16. Comme les pignons des maisons étaient tournés vers la rue, la pente des toits dirigeait les eaux de pluie vers la cour. Celles-ci n’étaient pas récupérées mais conduites vers les égouts par des cheneaux et des gouttières.
- 17. Dans le village-même de Schwarzenacker, des tuyaux en bois alimentaient certains ménages en eau fraîche.